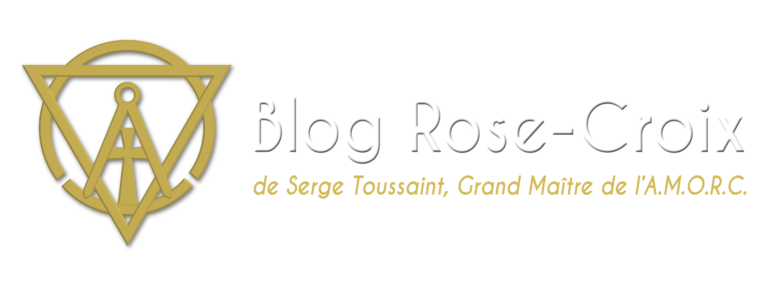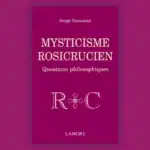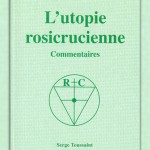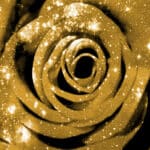Qu’est-ce que la bonté ?
Par définition, la bonté est « la qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres », ou encore « la qualité d’une personne bonne, portée à traiter les autres avec bienveillance, en s’abstenant toujours de leur nuire ». Au risque de vous sembler quelque peu naïf, je pense, à l’instar de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), que tout être humain possède cette qualité à l’état latent. Dans le « Contrat social », il déclare que « l’homme est naturellement bon » et que c’est la société qui le corrompt, au point qu’il peut en venir à se montrer malveillant, malfaisant, voire méchant. Il n’est pas le seul à avoir défendu cette idée ; d’autres penseurs et philosophes en ont fait le fondement de leur idéal et de leur enseignement.
« L’être humain est bon par nature »
Des psychologues ont effectué des expériences qui confirment que l’être humain est bon par nature. C’est ainsi qu’ils ont placé de jeunes enfants en la présence d’adultes en situation difficile : difficulté à traverser la rue, à porter une valise, à lacer une chaussure, etc. ; tous leur sont venus en aide spontanément et se sont montrés heureux de le faire. De même, ils ont été mis en présence d’animaux en situation difficile : un chat enfermé dans un carton, un chien emmêlé dans sa laisse, un oiseau égaré dans une pièce, etc. Là aussi, tous les enfants se sont portés au secours de ces animaux et ont manifesté leur joie de les avoir aidés. C’est en grandissant, sous l’effet des travers négatifs de la société, mais aussi en l’absence d’une éducation adéquate, qu’ils en viennent parfois à se montrer effectivement malveillants, malfaisants, voire méchants.
L’éveil de la bonté
Francis Bacon, éminent Rose-Croix du XVIIe siècle, a déclaré : « La bonté est la plus noble des facultés de l’âme humaine et la plus grande des vertus ». D’un point de vue rosicrucien, il est vrai que la bonté est une vertu, comme le sont la bienveillance, l’altruisme, la tolérance, la non-violence, etc. Tout être humain les possède à l’état latent, mais il doit faire l’effort de les éveiller pour qu’elles se manifestent à travers ses jugements et son comportement. S’il ne le fait pas, ce sont les faiblesses et les défauts opposés qui prennent le dessus : malveillance, égoïsme, intolérance, violence, etc. En principe, l’éducation a pour but majeur d’inculquer ces vertus aux enfants, afin que devenus adultes, ils les expriment au contact des autres et soient une bonne compagnie pour eux.
« Bonté » et « Bienveillance »
On pourrait penser que bonté et bienveillance ne sont qu’une seule et même vertu. Ce n’est pas vraiment le cas. En effet, être bienveillant, c’est plutôt faire preuve de gentillesse et d’indulgence à l’égard d’autrui. C’est donc avant tout un état d’esprit, une disposition intérieure. Être bon, c’est agir pour le bien d’autrui. Dans une certaine mesure, on peut dire que la bonté est la mise en pratique de la bienveillance. Cela étant, les personnes bienveillantes sont généralement bonnes, et inversement. C’est pourquoi les mots « bienveillance » et « bonté » sont souvent présentés comme synonymes et mis en relation avec l’altruisme, la générosité, la mansuétude, la clémence, etc.
« Être bon pour soi-même »
S’il est bien de faire preuve de bonté à l’égard d’autrui, il faut également être bon pour soi-même, d’où l’adage « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Cela suppose de s’accorder régulièrement de beaux moments, de belles rencontres, des plaisirs divers, des loisirs variés, etc. On peut d’ailleurs se demander si une personne qui n’est pas bonne pour elle-même peut l’être pour les autres ? Si vous pensez vous aussi que la bonté est une faculté de l’âme, elle doit rayonner autant pour nous-mêmes que pour autrui, tel le soleil qui nous éclaire tout autant qu’il éclaire les autres, d’où ce proverbe Sioux : « Chaque acte de bonté est comme une goutte d’eau traversée par un rayon de soleil ».