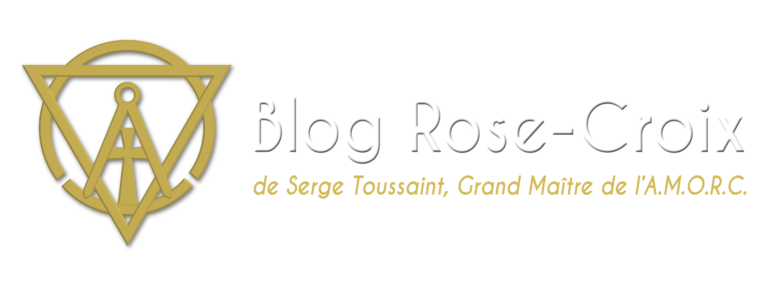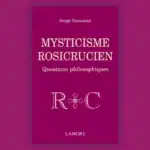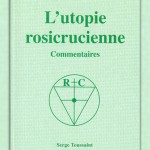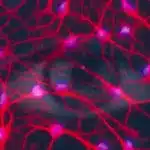Définition du mot « culpabilité »
Avant d’expliciter ce qu’il en est du sentiment de culpabilité, il importe de rappeler la définition du mot « culpabilité » : « État d’une personne qui est coupable d’une infraction ou d’une faute ». D’une manière générale, ladite infraction ou faute a été commise à l’encontre des lois en vigueur et vaut à celui ou celle qui l’a commise une sanction ou, pire encore, une condamnation. Dans les cas les plus graves, cette condamnation peut aller jusqu’à l’emprisonnement, voire la peine de mort. Cela suppose que la culpabilité de cette personne ait été clairement établie, prouvée, démontrée, à travers une procédure judiciaire impartiale. Dans le cas contraire, c’est la « présomption d’innocence », autrement dit la présomption de non-culpabilité, qui est censée prévaloir. De toute évidence, ce n’est pas toujours le cas.
Le sentiment de culpabilité
Le sentiment de culpabilité, quant à lui, n’est pas la résultante d’une procédure judiciaire. Comme son nom l’indique, il est un sentiment qu’une personne nourrit d’elle-même à son encontre, soit parce qu’elle est convaincue d’être coupable d’une infraction ou d’une faute, soit parce qu’on l’a convaincue qu’elle l’était. Dans les deux cas, ce sentiment la perturbe, l’affecte, parfois même la sclérose, au point qu’il peut se transformer en une véritable psychose. Vous noterez également que plus un individu manque de confiance en lui, plus il a tendance à culpabiliser lorsqu’à tort ou à raison il pense avoir commis une erreur de jugement ou de comportement. Il est alors très difficile de l’amener à se déculpabiliser et à prendre du recul.
« C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très grande faute »
S’il est un fait que certaines personnes, en raison de leur tempérament et de leur vécu, ont plus ou moins tendance à culpabiliser, on ne peut nier que certaines religions, en particulier le catholicisme, ont contribué à inculquer et entretenir le sentiment de culpabilité. Ce n’est pas là une critique, mais un constat. Lorsque j’étais enfant, j’allais au catéchisme, comme la plupart de mes camarades. Je me souviens encore d’une supplique que nous devions savoir par cœur et qui se terminait par : « c’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très grande faute ! » Déjà, à l’époque, cela me semblait très culpabilisant, d’autant plus qu’au moment où on nous demandait de réciter cette supplique, je n’avais pas le sentiment d’avoir particulièrement mal agi. Néanmoins, cela m’inclinait à penser que je l’avais probablement fait, mais que je n’en avais pas conscience.
« Le sentiment de culpabilité est néfaste »
Comme le confirment tous les psychologues, le sentiment de culpabilité est néfaste, notamment lorsqu’il est “chronique”, car, comme je l’ai indiqué précédemment, il est perturbant, affectant et parfois sclérosant. Certes, il est normal, pour ne pas dire naturel, d’avoir « mauvaise conscience » lorsque nous avons mal agi. En cela, la « voix de notre conscience » est un guide très utile ; sans elle, les êtres humains se laisseraient davantage encore influencer par leurs faiblesses, leurs défauts et leurs instincts destructeurs. En fait, c’est elle qui nous incite à faire le bien, c’est-à-dire à exprimer ce qu’il y a de meilleur dans la nature humaine : bienveillance, générosité, tolérance, non-violence, etc., ce que les Rose-Croix s’évertuent à faire au quotidien. Lorsque nous le faisons, nous avons alors « bonne conscience ».
Cultiver la confiance en soi
Que faire pour ne pas nourrir le sentiment de culpabilité ? Bien qu’il n’y ait pas de “solution miracle” pour y parvenir, il me semble que le mieux est de cultiver la confiance en soi. Comment ? En conscientisant autant que possible les aspects positifs de notre personnalité : nos qualités, nos dons, nos aptitudes, nos savoir-faire… Parallèlement, il faut nous affranchir du jugement des autres et nous délivrer de tous les dogmes culpabilisants, qu’ils soient religieux ou sociétaux. Je pense également qu’une démarche spirituelle fondée sur le « connais-toi toi-même » peut être d’une aide précieuse. En effet, l’âme qui nous anime, au sens de nous donner vie et conscience, aspire à nous libérer de tout ce qui est susceptible de nous affecter intérieurement et de compromettre notre bonheur.